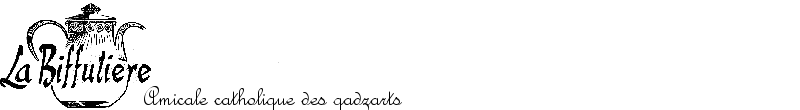« L’Honneur d’être ouvrier » – Abbé Victor Dillard
- 09
- Avr
- Posté par : Foucauld Roussel
- Catégorie : Formations, Thèmes de réflexion
« L’Honneur d’être ouvrier » par l’Abbé Victor Dillard
Sur proposition de Foucauld Roussel, Li209
Le texte ci-dessous a été écrit par l’abbé Victor Dillard, jésuite et aumônier clandestin du STO, interné en 1944 au camp de Dachau, où il meurt en 1945.
Tiré de «Les sorciers du Ciel» de Christian Bernadac (1969).
« Pendant plus de six mois, j’ai eu l’immense avantage de vivre aussi complètement que possible la vie ouvrière. Je dis bien aussi complètement que possible, car en réalité je n’ai pas été, je ne pouvais pas être ouvrier. Je m’en suis rendu compte à l’attitude des autres qui ne m’ont jamais totalement pris pour un des leurs. Je n’ai jamais pu décider Mêko, le Russe, qui fut comme  électricien mon compagnon de travail, à me tutoyer, quelque chose l’en empêchait. Et j’ai compris peu à peu qu’ils avaient raison. Ne devient pas ouvrier qui veut. Il existe une culture ouvrière qui ne se jauge pas avec les barèmes de la culture tout court. Je sais maintenant ce que cela veut dire « l’honneur d’être ouvrier » autrement que par les discours et par la poésie.
électricien mon compagnon de travail, à me tutoyer, quelque chose l’en empêchait. Et j’ai compris peu à peu qu’ils avaient raison. Ne devient pas ouvrier qui veut. Il existe une culture ouvrière qui ne se jauge pas avec les barèmes de la culture tout court. Je sais maintenant ce que cela veut dire « l’honneur d’être ouvrier » autrement que par les discours et par la poésie.
 électricien mon compagnon de travail, à me tutoyer, quelque chose l’en empêchait. Et j’ai compris peu à peu qu’ils avaient raison. Ne devient pas ouvrier qui veut. Il existe une culture ouvrière qui ne se jauge pas avec les barèmes de la culture tout court. Je sais maintenant ce que cela veut dire « l’honneur d’être ouvrier » autrement que par les discours et par la poésie.
électricien mon compagnon de travail, à me tutoyer, quelque chose l’en empêchait. Et j’ai compris peu à peu qu’ils avaient raison. Ne devient pas ouvrier qui veut. Il existe une culture ouvrière qui ne se jauge pas avec les barèmes de la culture tout court. Je sais maintenant ce que cela veut dire « l’honneur d’être ouvrier » autrement que par les discours et par la poésie.Pour être ouvrier, il aurait fallu que mon corps fût façonné, sculpté pour cet usage. L’ouvrier ne travaille pas seulement avec ses mains, c’est tout son corps qui est engagé dans la bataille, la passionnante et amoureuse bataille avec la matière. Quand mes yeux ont été brûlés par l’arc de la soudure électrique, mes oreilles accordées à l’assourdissant ronflement des machines ou au martèlement des tôles, mes jambes, mes genoux habitués à la voltige des escalades dans les charpentes métalliques, tous mes muscles tendus pour le serrage d’un boulon ou le décrochage d’une mèche, les poumons rompus à la respiration empoussiérée du métal qui vous pénètre, tout le corps rhumatisant de courants d’air malsains et strié de cicatrices diverses, j’ai compris que si j’avais vécu cela depuis mon enfance, mon être ne serait pas ce qu’il est, et ma sensibilité serait différente.
Il faut avoir été sur place, personnellement engagé dans la symphonie, pour se rendre compte que les mains ne peuvent pas être propres ni les ongles impeccables quand on a travaillé dans le cambouis. J’ai dit là -bas la messe avec des mains ignobles mais triomphales. On ne peut pas se servir d’un mouchoir avec des mains pareilles, et l’on doit se moucher avec ses doigts. J’ai compris que le fait de cracher par terre était une défense instinctive de l’organisme, et que l’hygiène était un luxe méritoire et pour certains quasi inabordable. Le vieux Dory qui travaillait avec moi à la soudure autogène touchait sans se brûler les gouttes de métal en fusion, il avait fait cela toute sa vie.
Je me souviens d’avoir, un jour, pendant l’hiver, réparé le moteur du pont roulant extérieur. Je travaillais sur le haut du pont, en plein vent qui glaçait complètement tout le corps. Il me fallait dévisser entre le pouce et l’index de minuscules vis qui résistaient ferme. Je ne sentais pas mes doigts, ils étaient violets. Je n’ai pu m’en tirer qu’en descendant de l’échelle toutes les cinq minutes pour courir me dégeler les mains sur un brasero et je suis resté longtemps après avoir fini, incapable de faire un mouvement et pleurant de froid. J’ai vu Mêko, en d’autres occasions, réparer le même moteur. Lui tenait le coup : il savait; il est vrai qu’il était russe. Il avait une manière à lui de dégeler ses doigts en se frottant les cheveux qui étaient souveraine. Et puis, il était ouvrier depuis toujours.
Si l’esprit est conditionné par la sensibilité, rien d’étonnant qu’il y ait une mentalité ouvrière, une pensée ouvrière, qui restera toujours étrangère aux philosophes et aux savants. Et cette mentalité est encore façonnée par l ‘objet sur lequel elle s’exerce. Il faut avoir travaillé pour comprendre la matière et sa beauté et son mystère et sa vie. Car la matière est vivante, je ne savais pas cela non plus. Dans mon domaine d’électricien, cette vie était peut-être plus sensible qu’ailleurs; pourtant, il me semble que les camarades l’expérimentaient comme moi même. La machine a une âme. Elle a ses moyens d’expression à elle; elle a ses bruits, imperceptibles à tout autre qu’à son conducteur, ses plaintes, ses maladies, ses caprices, ses manies. Il existe un accord tacite entre elle et son maître, des habitudes réciproques, une collaboration d’impondérables. L’ouvrier ne travaille pas avec n’importe quel outil, fut-il le plus élémentaire, mais avec son outil, celui qui est marié à sa main depuis toujours. On dira que mon imagination travaille, et que tout cela est poésie. Je pense qu’il y a bien plus que cela, et que ce n’est pas par hasard que le Christ a voulu être ouvrier. Il a aimé le bois, dont il connaissait tous les secrets, dans la familiarité d’ une collaboration de vingt années. Il est né sur ce bois dans la crèche et il a voulu mourir dans l’étreinte sanglante de son ami, de son frère, le bois. De nos jours peut-être, aurait-il aimé le fer comme il aima le bois, il aurait travaillé avec passion la soudure et le tour et l’ajustage, et il aurait communié par là avec cette matière qu’il connaissait si bien, dans tous ses secrets, comme il connaissait le vent, la tempête et les poissons du lac.
La réparation d’une machine est source des mêmes joies que la création artistique. Je me souviens d’une machine à soudure électrique (un couple transformateur moteur et dynamo), qui avait rompu ses amarres pendant un transport par le pont roulant et était tombée de 10 mètres de haut. La machine gisait là , debout sur ses deux petites roues de derrière, comme un chien malade, et Mêko se tordait de rire en la regardant. On a travaillé dessus pendant trois jours, sans arrêt, réparant tout, pièce par pièce, le timon, les roues, les condensateurs, les interrupteurs, etc., etc. On l’a remontée complètement et puis, prudemment, on a essayé de lui redonner la vie en la branchant sur le courant. Cela n’allait pas au début, ensuite cela alla mieux. Mêko l’a réglée en fin connaisseur, jusqu’à ce que les sonorités soient exactement accordées, l’arc impeccablement ajusté à la soudure. Et quand elle a roulé à point, ce fut pour nous deux une joie inexprimable d’avoir ranimé ce cadavre, de sentir que par nous il y avait une vie de plus dans l’usine, comme si un enfant était né. Ce sentiment de la paternité ouvrière est peut-être un des plus forts que j’aie jamais connus; il me semble que je pourrais revenir dans des années et des années, j’irais reconnaître tout de suite si l’interrupteur de sécurité que j’ai confectionné pour la perceuse, si le trolley aérien que j’ai ajusté au pont roulant, si les circuits suspendus de la sirène d’alarme, fonctionnent encore, parce que tous ceux-là sont mes enfants, et je ne puis songer à eux sans un sentiment d’intense fierté, la fierté ouvrière. Quand le Christ, plus tard est repassé à Nazareth, j’imagine qu’il a dû jeter un coup d’Å“il sur telle ou telle charpente où il avait mis davantage de lui-même, et qu’il a demandé à Jacques ou à Gédéon des nouvelles de sa charrue.
Je m’inquiétais autrefois de savoir comment pouvaient fonctionner en Allemagne ces invraisemblables usines internationales où travaillait une population hétéroclite de Russes, de Serbes, de Polonais, d’Italiens, de Français, etc. J’ai compris sur place que le lien entre tous ces hommes n’était pas la destination de leur travail (sur laquelle ils ne s’entendaient évidemment pas), mais la simple communion collective avec la matière, quelque chose comme un corps vivant du travail. Quand je revoyais, en traversant. les ateliers, trois compagnons frapper les rivets à la masse, un Russe, un Allemand, un Français, et que j’admirais le synchronisme impeccablement précis de leurs gestes, le rythme harmonieux de leur frappe, je pensais qu’au-dessus des contradictions du Weltanschauung et des incompréhensions de langue, il y a une solidarité essentielle de travail, et que le lien par la matière est aussi puissant peut-être que le lien de l’ esprit. L’internationale ouvrière n’est. pas seulement une élucubration marxiste, mais une réalité tangible. Et il fallait que le Christ vint et fût ouvrier et s’incarnât en la matière eucharistique pour que l’opacité de cette matière fût vaincue et que cette communion matérielle devint une communion d’amour. Car les hommes, sans lui, s’arrêteraient à la matière pure sans comprendre son âme. Comme ils ont su la prostituer contre nature pour l’asservir aux instruments de mort, ils savent aussi prostituer sa fonction réconciliatrice pour l’asservir aux oeuvres de division et de haine. Et ceci est un sacrilège, car la matière est sainte.
Cette découverte de la matière et de sa fonction unificatrice m’a conduit à « réaliser » , au sens anglais du terme, une échelle de valeurs que je ne faisais que soupçonner. La hiérarchie du travail n’est pas simplement une question de rendement, d’autorité, ni même de compétence. Elle a une valeur en quelque sorte ontologique. Je ne parle pas ici de la hiérarchie officielle des contremaîtres, ingénieurs, etc. Je parle de ceux qu’à l’ intérieur de l’usine on considère comme les bons ouvriers. Leur salaire n’est pas toujours caractéristique de la valeur. En dehors du travail, ils peuvent ne présenter aucune qualité humaine, ils peuvent être balourds, ivrognes ou immoraux. A leur place, dans l’usine, ils sont comme transfigurés; ils sont ceux qui savent. Ni la matière, ni l’outil n’ont de secret pour eux, ils opèrent des miracles de précision, de fini, de fignolé, qu’il faut avoir surpris pour les croire opérés de main d’homme. Ils ont des diagnostics infaillibles, des coups de main qui valent ceux d’un chirurgien de marque, des habiletés de fleurettiste, ils sont les artistes, les grands artistes du métal. Je vois encore Meyer, le gros Meyer, l’as de la soudure, que l’on appelait d’un bout à l’autre de 1’usine dès qu’il s’agissait d’une opération délicate. C’est lui qui m’a soudé bout à bout des fils de cuivre trop courts, sans qu’on puisse découvrir où était la soudure, j’allais dire la cicatrice. Je pense à cet électricien de chez Huhan qui montait de temps en temps à l’usine et vous opérait en un tournemain les jonctions les plus scabreuses de courant à haute tension. Et combien d’autres. Tous ceux- là méritent un respect qu’on ne leur décerne guère en dehors du cercle infime de ceux qui les voient travailler. Ils sont les ignorés, les méconnus sociaux, ceux auxquels on dénie parfois toute valeur humaine. D’autres aux mains propres et au col immaculé se font saluer « cher maître », se pavoisent de rosettes et s’encadrent de publicité. Eux resteront comme ouvriers, inconnus même de leur femme et de leurs gosses, de leurs amis, parce qu’ils ne sont virtuoses que de la matière, comme si ce travail ne conférait pas une noblesse, comme s’il n’était pas, lui aussi, création et parfois oeuvre de génie.
Il faut avoir vécu cela pour comprendre que Dieu s’est fait charpentier. »
Source :Â http://ab2t.blogspot.fr/2014/04/verbatim-abbe-victor-dillard-lhonneur.html