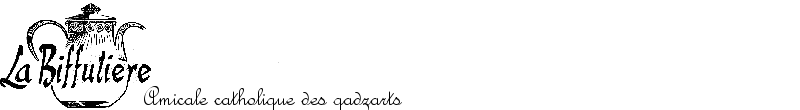M̩ditation contemplative de notre camarade Gabriel Robert (Cl 53) РP̬re Jean de la Croix, moine b̩n̩dictin
- 12
- Juil
- Posté par : Gabriel Robert (Cl 53)
- Catégorie : Thèmes de réflexion
 CROIRE : MA VIE, UN DEFI
Introduction
 « Croire » est un comportement fondamental de l’homme, car nul ne peut vivre sans croire : croire en une parole, en un amour, en une promesse, en une fidélité…Cette foi, toute humaine et spontanée, demeure fragile et vulnérable ; elle ne peut, en effet, que s’offrir au risque de l’autre.
C’est ainsi que ce ‘croire’, sans lequel nulle vie ne peut se fonder et se construire, est tout à fait révélateur de ce qu’est l’être humain dans ses limites et sa finitude. Celui-ci ne sera jamais une totalité suffisante et accomplie ; il restera toujours un être dépendant et, qu’il le veuille ou non, un être de toute relative autonomie.
Comment vivre, en effet, sans un regard de tendresse ou d’amitié penché sur soi, sans une main fraternelle ou secourable tendue vers soi ? Une autonomie, certes, est indispensable, mais, jamais, elle ne pourra se conquérir dans l’absolu ; une telle quête serait vaine, voire même dangereuse. Il est plus sage de s’ouvrir à la rencontre de l’autre et à l’heureuse dépendance d’un amour et d’une foi, plutôt que de sombrer dans une folie assurée.
Ce qui constitue le plus simple et le plus vrai de nos vies humaine offre donc une première lumière sur le ‘croire’ qui spécifie le chrétien et même l’identifie. Il y a, et c’est heureux, une cohérence profonde entre ce que nous sommes, en nos humanités concrètes et quotidiennes, et ce que nous avons à accueillir et à vivre à la lumière de l’Evangile.
A propos de la Torah, Jésus a déclaré qu’il n’était pas venu abolir mais accomplir. Ces paroles valent tout autant pour tout homme puisque Jésus est aussi venu pour l’accomplir, c’est-à -dire le restaurer dans sa vérité, sa dignité, sa liberté, c’est-à -dire le rendre à cette merveilleuse dépendance qui consiste à être, dans la grâce de l’Esprit, disciple de Jésus Christ, fils du Père, et frère ou sÅ“ur de tout être humain.
Jésus seul, chemin de Dieu vers nous et chemin de nous vers Dieu, peut donc nous mener, en toute certitude, à la conquête de cette liberté qui nous donne de nous perdre pour nous gagner, de livrer notre vie à chacun de nos frères, tout en devenant ‘Amen’ à la volonté du Père. Telle est bien l’espérance inscrite au cœur même de la prière chrétienne : « Que ta volonté soit faite, comme au ciel ainsi sur la terre ».
Croire quoi :
Au centre même de notre foi, il y a cette certitude : en Jésus, Dieu s’est fait homme, vrai homme, et même l’homme vrai. Les Pères de l’Eglise auraient dit : il s’est fait homme pour nous sauver, pour nous rendre participants de sa divinité ; telle est la théologie des grands Conciles christologiques des premiers siècles de l’Eglise.
Nous préférons dire, aujourd’hui – ce qui n’est pas faux si nous le comprenons bien – que Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit. Dieu seul, par appel et par grâce, peut sauver l’homme en l’humanisant, en lui donnant de pouvoir devenir personne, authentiquement, à l’image de Dieu même.
Voilà , peut-être, ce qu’il faut oser croire et témoigner aujourd’hui. Un ‘croire’, tout comblé par cette certitude, afin de proclamer, à la face du monde, que si l’homme n’est que pour Dieu, il ne peut être que par Dieu. Oui, l’homme ne peut naître à lui-même, à sa vérité, à sa liberté, à sa pleine humanité que s’il naît de Dieu, comme Jésus, une nuit, le révéla lui-même à Nicodème.
Il faudrait nous recueillir sur cette certitude pour l’accueillir au plus profond du silence intérieur. C’est seulement de ce silence que pourra jaillir une parole qui soit de lumière et de vie ; une parole, parce que Dieu aura jeté sa semence au sillon de notre propre chair, parce que Dieu aura labouré notre cœur de pierre pour le recréer cœur de chair !
Croire en qui :
Avoir des convictions sur ce qu’il faut croire ne suffit pas. A cela, il faut des racines plus profondes encore, des racines sans lesquelles nous ne pourrons conquérir et assumer notre propre identité. Car il faut savoir qui nous sommes afin de répondre à la question que l’homme se pose depuis les origines : « Qui suis-je ? ».
Ce que les philosophes n’ont jamais pleinement découvert, ce que les sagesses du monde, malgré leur part de vérité, ont toujours ignoré, le chrétien, lui, le pressent d’instinct. Il sait qu’il ne peut répondre à cette question qui le concerne au cœur même de son humanité, à ce ‘Qui suis-je ?’ qui donne sens à toute sa vie.
Il y a aussi le « Qui suis-je ? » qui traverse tout l’Evangile et même le soulève, cette question que Jésus adresse à ses disciples, à Césarée de Philippe. Telle est bien la question essentielle, et même originelle, au cœur même de la Révélation. Oui, l’homme ne peut savoir qui il est, s’il ne sait d’abord qui est Jésus Christ.
Quand Jésus lui-même pose cette question à ses disciples, et donc à chacun de nous : « Pour vous qui suis-je ? », il nous faut bien comprendre qu’une telle parole ouvre sur une double perspective.
Jésus nous appelle à découvrir qui il est, comme révélation parfaite du Mystère même de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint ; qui il est comme Envoyé du Père, dans la mission qui est la sienne ; Jésus, en effet, est ce qu’il accomplira pour nous dans sa parfaite obéissance au Père.
Mais il nous appelle aussi à découvrir qui il est, lui, pour que nous puissions accéder à notre identité la plus profonde et la plus vraie. En effet, quand Jésus se dit, il me dit. Son propre « Je » fonde le mien dans le « tu » qu’il m’adresse. C’est ainsi que Jésus, le Révélateur de Dieu, est aussi le Révélateur de l’homme car, dans la lumière de l’Evangile, il se manifeste et Dieu et homme, sans confusion aucune, en toute plénitude et vérité.
La réponse de Pierre au « Pour vous qui suis-je ? », Jésus la reconnaît et la confirme comme le fruit d’une lumière d’en haut : « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t’est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux » (Mt 16,17).
Cette vérité de Jésus de Nazareth, Messie et Fils de Dieu, ne peut jaillir du cœur de l’homme ; en effet : « Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père » (Mt 11,27). C’est donc le Père seul qui peut nous révéler le Fils à condition que notre cœur et notre esprit s’ouvre à cette lumière de révélation.
Cette réponse, pourtant, ne suffit pas. En effet, nulle formule, même juste et conforme à la révélation de Dieu, ne peut définir qui est Jésus, le Verbe fait chair ; c’est déjà vrai quand il s’agit de l’homme ! Que dire, alors, quand il s’agit du Fils de Dieu ?
Il faut que cette confession de foi soit elle-même évangélisée, c’est-à -dire reliée à tout l’Evangile : aux paroles, aux silences et aux gestes de Jésus de Nazareth. Il faut qu’elle soit éclairée, confirmée en chaque rencontre d’Evangile : avec les foules, les apôtres, les pharisiens, les publicains, avec Pierre, Thomas, Nicodème, Zachée, le bon larron et le Centurion et tous les autres.
Il faut qu’il soit lumière sur le candélabre, c’est-à -dire pour tous ceux qui, tout au long de l’Evangile, ont reconnu, en Jésus, leur Sauveur et leur Dieu ; il faut aussi qu’elle soit enfouie, comme le levain dans la pâte, dans la nuit du monde, c’est-à -dire dans toute l’épaisseur du refus des hommes, et même dans cette vague de haine qui monte peu à peu, et qui va enrouler Jésus dans ce linceul de mort pour le réduire à l’impuissance de la Croix.
Mais il fallait cet extrême de l’humaine et diabolique violence pour que la douceur de Dieu se révèle et, victorieuse, triomphe du péché et de la mort. Il fallait ce sommet – Jésus élevé de terre – pour que triomphe, à la face du monde, le Crucifié Ressuscité.
La réponse de Pierre, le Credo de l’Eglise, tout le dogme chrétien, sont les lumières indispensables pour entrer dans l’intelligence de l’Evangile et de la vie qu’il nous offre. Il s’agit d’écouter Celui qui est la Parole vivante et éternelle, pour y contempler Celui qui est le Révélateur du Père et de toute son œuvre de création et de rédemption.
Toute formule reste vide et sonne creux si manque la vie qui doit tout investir de l’esprit et du cœur : une vie toute puisée à l’école du Rabbi de Nazareth, dans l’écoute de sa Parole ; une vie goûtée au silence de la prière, dans la communion au Pain de vie descendu du ciel.
Une vie qui devient nôtre qu’en étant toute reçue d’en haut, une vie dont nous ne serons jamais la source mais seulement le sanctuaire : « Qu’as-tu que tu n’ais reçu ? » (1 Cor 4,7). Cette vie reçue peut devenir nôtre en toute vérité dans le ‘oui’ libre de la foi, dans le consentement de l’espérance et de l’amour.
Â
Croire en qui : connaître Jésus Christ
Paul aurait pu nous dire : « Qui es-tu que tu n’ais reçu ? » ; qui es-tu qui ne soit, en ta vie, la présence même de Jésus Christ puisqu’il vient, comme il l’a promis, demeurer en nous pour que nous demeurions en lui ?
Si l’identité chrétienne est tellement liée à celle du Christ, tellement dépendante de la vie même du Christ en nous, comment ne pas, sans cesse, revenir au Centre que Jésus est pour toute la création, au foyer d’incandescence qu’il a voulu devenir en notre humanité et en son histoire ?
Qui est-il donc ce Jésus : « Fils de l’Homme… venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19,10). Jésus est cet homme qui, dans son humanité même, est venu vivre en notre monde, sa vie de Fils unique de Dieu.
Il vit parmi nous, avec nous et pour nous, de cette unité avec le Père, qui est leur communion de vie de toute éternité. C’est de cette intimité, au Mystère de Dieu dont Jésus va rendre témoignage, par une vie toute donnée et toute livrée au Père.
Cette vie de Jésus manifeste, en notre monde, la souveraine et éternelle liberté du Fils unique, dans l’humble et parfaite obéissance du Verbe fait chair, Jésus de Nazareth. Cette obéissance n’a d’autre fondement et d’autre motif que l’amour du Fils pour le Père, en parfaite réponse à l’amour infini et éternel du Père pour le Fils. Tout l’Evangile est cette manifestation – cette épiphanie – et, si nous avions des yeux pour voir, nous verrions et nous croirions.
Insistons pour reconnaître et affirmer que toute la vie du Christ est cette épiphanie de la communion trinitaire sous forme d’un engagement qui révèle et exprime sa propre liberté divine dans la plénitude d’une obéissance d’homme. Amour, liberté, obéissance : trois réalités d’identité et de vie qui, pour le Christ, comme pour nous, sont radicalement inséparables.
Cette obéissance du Christ, expression d’un amour et d’une liberté infinis, nous révèle, en un premier temps, l’identité même de Dieu ; ce n’est qu’en un second temps qu’elle prend valeur de rédemption. Le Christ est d’abord révélateur du Père et c’est, en cette révélation même, qu’il nous sauve. De même que c’est en nous révélant qui nous sommes qu’il inaugure pour nous son œuvre de salut.
Cette obéissance du Christ qui exprime, en notre monde, l’éternelle dépendance du Fils unique par rapport au Père, nous révèle que le Fils n’est rien qu’il n’ait reçu du Père. C’est dans cette relation que le Christ vit ; c’est elle qui constitue sa divine identité qu’il doit révéler au monde en son humanité même. Voilà l’Evangile et Jésus l’exprime ainsi : « Il faut que le monde sache que j’aime le Père… » (Jn 14,31).
Le Christ, tout au long de l’Evangile, manifeste un radical renoncement à sa volonté propre – « Père, non ce que je veux mais ce que tu veux » -, une absolue dépossession de lui-même afin de nous révéler ce qu’il est : pur élan d’amour vers Dieu, pur élan d’amour vers nous, dans une liberté qui est celle même de Dieu, possessive de rien, possédée par rien !
En tout cela, comprenons-le bien, Jésus se dit et nous dit. Ce qu’il est comme obéissance révélant son amour et sa liberté nous dit le Mystère trinitaire, mais en nous disant ce qu’il est comme nouvel Adam, Premier-né de toute l’humanité.
Si nous pouvions méditer le chapitre VI de Jean, nous aurions à reconnaître, en un premier temps, le don que Jésus est pour nous, don du Père comme Pain de vie. Mais Jésus ne peut être don sans ‘se’ donner lui-même aux hommes : « Le pain que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde » (Jn 6,51).
Il se donne en sa chair et en son sang, c’est-à -dire selon toute sa personne, et au terme Jésus peut proclamer : « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m’a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi » (Jn 6,57).
Tel est bien le message de Jésus : il se donne à nous, non pour être – comme tout aliment – assimilé par nous ; il se donne pour que, en mangeant le pain qu’il est, nous devenions ce qu’il est.
Ainsi notre vie passe en lui, sans séparation ni confusion selon le Concile de Chalcédoine ; et cette vie, par lui et en lui, c’est notre vie de fils de Dieu, de fils dans le Fils unique. Telle est notre pleine et parfaite identité. Ce qui confirme tout à fait que nous ne savons pas qui nous sommes si nous ne savons pas qui est Jésus Christ.
Croire : pour quoi ?
Autre question, dans la continuité des précédentes, mais nouvelle exigence. En effet, croire ne serait qu’une illusion, si l’on ne pouvait en donner les raisons. Le propre d’une liberté, c’est de pouvoir rendre compte de ce qu’elle engage, de ce qu’elle cherche, de ce qu’elle fait.
Une première réponse à la question : ‘Croire : pour quoi ?’, sous une forme quelque peu provocante, pourrait se formuler ainsi : Pour quoi ? Pour rien ! C’est-à -dire par pure gratuité ; par folie d’amour tout simplement. Car, aux grandes questions de la vie et de l’amour, il n’y a pas de réponse.
Pour quoi je t’aime ? Je n’en sais rien, et si je le sais quelque peu, par pudeur je n’en dirai rien ; l’amour vrai demeure toujours un secret. Je t’aime, non pour ce que tu me donnes ou pourrait me donner, mais d’abord et seulement pour ce que tu es ; parce que c’est toi. Je t’aime parce que tu m’es donnée et que j’essaye de t’accueillir dans ma vie comme un don qui, pour moi, vient de Dieu, et donc dans la liberté et la reconnaissance de la foi.
Ces paroles, qui rendent compte d’un amour, tout chrétien devrait pouvoir les adresser au Christ, puis les présenter à quiconque lui demanderait de rendre compte de sa foi. Sans oublier jamais qu’il y a des silences, des complicités de bonheur et de joie, qui valent toutes les justifications. Pensons aux amis de Job qui n’ont pas su donner la réponse que, d’ailleurs, celui-ci ne leur demandait pas ; Dieu seul le pouvait et il ne l’a pas fait !
Alors ‘croire pour quoi ?’ : peut-être pour la seule joie de Dieu, pour la seule gloire du Père. Car, il ne serait pas le Dieu qui m’aime en vérité, s’il n’était pas dans l’attente ardente de ma réponse à sa venue, à son appel et à sa révélation. C’est bien Jésus, en effet, qui par trois fois pose cette question : « Pierre, m’aimes-tu ? », et même « M’aimes-tu plus que ceux-ci ? », comme si Jésus était jaloux de l‘amour de son apôtre !
Cette attente du Christ, il nous faut la bien comprendre. Ce blessé, abandonné sur le bord de la piste, c’est le Seigneur lui-même. D’ailleurs, n’a-t-il pas déjà annoncé : « Vous me laisserez seul ». Comment alors ne pas rêver, et même croire, qu’un jour, par pure grâce, nous pourrions être le bon Samaritain de notre Dieu ?
Comment, ici, ne pas évoquer telle page du Journal d’Etty Hillesum, jeune femme juive internée à Auschwitz d’où elle ne reviendra pas et qui offre à Dieu, invraisemblable audace, de le sauver lui-même, mais de le sauver en elle : « C’est tout ce qu’il nous est possible de sauver en cette époque et c’est aussi la seule chose qui compte : un peu de toi, en nous, mon Dieu » (Journal, p. 166).
Croire pour que Celui qui meurt sur la Croix ne puisse pas me dire : « Pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Si je ne fais rien pour apaiser la détresse de mon Dieu, il ne me reste, sur la conscience et sur le cœur, que la mort : la sienne, la mienne, et un peu celle du monde.
Si ma foi, mon peu de foi, me donne d’être là , court instant de ma vie peut-être, petite consolation dans l’infini de sa souffrance et de sa Passion, peut-être qu’à la question posée, une humble réponse aurait été donnée. Comprenne qui pourra !
Ce qui est vrai, aux heures tragiques d’une existence d’homme, ce qui est impuissante mais effective présence de compassion, Dieu, en sa Passion, pourrait-il le refuser, voire le dédaigner ?
Croire : pourquoi ?
Parce que c’est ma mission et mon combat. Dès que Dieu naît en notre monde, sa mort est décidée. Cette décision demeure, elle s’est prolongée dans l’histoire de l’Eglise ; elle reste encore question pour le Ressuscité lui-même : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? ». Tant de Saul depuis vingt siècles, et aujourd’hui encore !
Il y a des combats dans la persécution, les combats sous le mépris et la dérision. Il y a, plus déconcertant et très actuel, les combats face à l’indifférence, au désintérêt, à la ‘décroyance’ ! Il y a une béatitude promise pour le persécuté, mais pour celui qui semble ne plus s’intéresser à rien, quelle espérance reste-t-il ?
Là , une réponse doit être donnée, une certitude peut nous redresser : l’indifférent qu’il soit mon frère ou le collectif quelque peu inconsistant qui s’appelle le monde, n’est jamais ce qu’il croit ou prétend être : une autonomie confirmée, voire proclamée : « Dieu, à quoi ça sert ? ». Or ce n’est qu’une autonomie illusoire, sans fondement ni consistance.
Ce frère et ce monde, qu’ils le sachent ou l’ignorent, qu’ils l’acceptent ou le refusent, sont déjà dans le pardon de Dieu, et déjà sont des sauvés. Sous la croûte des refus tranquilles ou arrogants, l’Esprit Saint est déjà là , à l’œuvre en eux, et plus vivant qu’ils ne le pensent.
Le chrétien est fort de cette certitude de foi que l’Esprit précède toujours sa propre mission. Il n’est que l’ouvrier de la dernière heure : la Pentecôte est accomplie ; mais comment ouvrir les yeux des aveugles, l’oreille des sourds, le cœur des suffisants et des indifférents, à Celui qui les habite et qui, déjà , dans sa lumière et son amour, les a saisis. Comment leur donner de naître à la Source qui, en eux, attend qu’ils s’éveillent à sa présence ?
Croire, un défi !
Le défi, lancé à notre foi, le voici annoncé. Il pourrait se décrire de bien des façons et, sous une forme ou sous une autre, tous, chaque jour, nous le rencontrons. Il nous blesse, il nous déconcerte ; il nous renvoie aussi à notre propre identité et, parfois même, il pourrait la menacer. Il pourrait même nous démobiliser : comment tenir, en effet, quand on ne voit jamais – ou presque – les fruits de nos missions, mais seulement les cactus aux déserts de refus ?
S’il fallait établir un diagnostic de première urgence, nous pourrions dire que la foi, malgré tout, nous la gardons et qu’elle nous garde, mais l’espérance ? Elle est toujours l’ancre du navire ; mais que celui-ci soit échoué sur les rochers de la côte, ou livré à la tempête et à ses vagues, quel rôle lui reste-t-il et comment le jouer ?
Le défi lancé, il faut le relever. C’est une question de vie : notre identité s’y trouve impliquée ; notre dignité, engagée ; notre fierté, interpellée. Croire ne suffit pas, il faut aussi être crédible ; chacun et tous ensemble, et cela reste vrai pour l’Eglise elle-même.
Ce défi que le monde nous lance par son indifférence, par sa suffisance, voire même par son arrogance, nous ne pouvons, chrétiens, le saisir et le relever qu’en veillant, avec grande sollicitude, les uns sur les autres, pour que, dans ce face à face avec le monde, nous restions ce que nous sommes.
La foi ne se bricole pas. De toute façon, elle ne nous appartient pas et l’Eglise ne nous la confie pas pour que nous en rabotions toutes les exigences et les âpretés. L’Evangile que nous avons à vivre et proclamer, nous n’avons pas le droit de le délayer ; un Evangile à l’eau de rose ne s’enfouira jamais dans la pâte du monde pour la soulever et la rendre enfin digne de Dieu et digne de l’homme. Un Credo, avec sauce au goût du jour, récrit dans l’ignorance de la Tradition de l’Eglise, ne sera jamais sel pour notre terre !
La rigueur nécessaire ne devra jamais, cependant, déraper dans la rigidité ; l’une est exigence de vie, l’autre est signe de mort. La doctrine est requise, mais l’endoctrinement ne convient nullement ; quant au fanatisme, il n’a jamais servi l’Evangile du Seigneur Jésus Christ.
La Parole que le monde attend, et dont il a tant besoin, reste toujours le « Viens, suis-moi » : celui de Jésus pour les apôtres, celui de l’Eglise pour chacun de nous, celui de tout chrétien pour chacun de ses frères.
Au défi, ainsi lancé, le succès n’est nullement promis. Comment être sûr, en effet, qu’il sera contagieux du Christ et séduisant d’Evangile ? L’insuccès, cependant, n’en appelle nullement aux lamentations et à l’amertume ; le chrétien ne peut jeter ni la première pierre ni l’éponge. Il n’a personne à attaquer, il n’a surtout pas à se défendre. Il doit seulement acquérir la patience, cette vertu qui est éminemment celle de Dieu pour tous les cœurs lents à croire, les nôtres d’abord, puis ceux de nos frères qui n’entendent pas et ne voient pas que Dieu est, présent, Dieu de tendresse et de miséricorde !
L’insuccès est une invitation discrète que Dieu nous adresse : son heure n’est pas encore venue, ce n’est donc pas le moment favorable. Le jour du salut, il faut que ma patience l’enfante pour le monde. Dieu viendra, le doute n’est pas permis. Il frappera à la porte en disant : « Me voici ». Seul, l’éveillé saura l’accueillir et alors, c’est dans l’imprévisible de toute rencontre que se jouera le libre destin de tout homme et de tous les hommes.
L’insuccès ne doit jamais conduire à l’abandon et au désespoir ; il nous conduit peut-être là où nous n’aurions pas choisi d’aller ; là où dans les ténèbres qui nous attendent, il faut que nous déposions notre vie pour achever, en notre chair, ce qui manque à la Passion du Christ pour le salut du monde.
Le chrétien, comme le Christ, n’est pas envoyé dans le monde pour acquérir une gloire humaine et accéder au podium du succès. En tout, il n’est jamais que le serviteur du Seigneur et de son Evangile, serviteur jamais au-dessus de son Maître ; serviteur toujours inutile et cependant joyeux de pouvoir témoigner que, malgré tout, la puissance de Dieu se déploie dans sa faiblesse (Cf. 2 Cor 12,8).
Ton Eglise, c’est quoi ?
Face au monde, il y a donc ce risque du ‘croire’ qui peut soit rencontrer une attention et une bienveillance, soit se heurter à l’indifférence ou au refus. C’est l’imprévisible de la mission.
Le disciple qui a répondu au « Viens, suis-moi » doit, un jour ou l’autre, entendre le « Va » que Jésus exige de lui. « Va chez toi, auprès des tiens, et rapporte- leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde » (Mc 5,29). « Va trouver mes frères et dis-leur… » (Jn 20,17).
Sur ce point, une fois encore, l’Evangile s’ajuste à nos vies d’homme. S’il nous faut des racines, il nous faut aussi des ailes :
 « Pour vivre debout et avancer, il nous faut des racines, c’est-à -dire une identité, une culture. Mais il faut aussi des ailes, c’est-à -dire une ouverture sur le monde, un projet, une utopie. N’avoir que des racines, c’est se recroqueviller sur soi ; n’avoir que des ailes, c’est se donner un destin de feuille morte. Par son message, Jésus offre à la fois l’enracinement et la nécessaire envolée. Aller vers la vérité, c’est aller vers l’autre. Il y a là une clef indispensable pour notre société : le chemin de la vérité passe par l’écoute de l’autre. Le Christ ne nous invite pas à d’autre chose qu’à sortir de nous-mêmes ».[1]
C’est cette même inquiétude concernant la société actuelle, le monde qui est le nôtre, tellement incertain face à son avenir, que nous retrouvons dans une autre interview :
« L’atomisation de l’être ensemble… nous sommes assez inattentifs à la perte du lien parce que nous sommes encore grisés par la conquête récente de l’autonomie individuelle. Nous avons du mal à comprendre de quel prix elle se paie. L’individu souverain devient un individu orphelin, solitaire, anxieux de sa propre solitude, de sa propre liberté. C’est le lien avec l’autre qui me constitue comme être humain. Si je perds le lien, je perds mon identité. Je ne suis plus rien ».[2]
Partir vers le frère, c’est un exode vers l’inconnu, comme pour Abraham : « Va vers le pays que je te montrerai ». Chaque frère est cette terre nouvelle qui nous attend, non pour que nous en fassions la conquête et en prenions possession, mais pour que nous le découvrions comme le trésor de l’Evangile, comme le don offert, déjà , à notre respect et à notre reconnaissance.
Chaque frère est une terre lointaine et nous partons vers lui, sans savoir qui il est, mais, cependant, riches de notre foi, d’une parole, d’une sagesse, et nous pressentons que nous aurons beaucoup à lui donner et, peut-être même, à tout perdre de notre vie.
Or, voici que, là où nous arrivons, il faut, à l’évidence, commencer par nous taire, pour écouter, comme ceux qui ne savent pas. Notre esprit et notre cœur doivent s’ouvrir à des richesses et à des pauvretés, à des silences et à des questions que nous n’avions pas prévus. Nous venions pour donner, il faut d’abord consentir à recevoir.
Avant de croire à notre parole, l’autre nous invite à accueillir la sienne, et celle-ci contraint la nôtre au silence. Nous venions pour annoncer Jésus Christ et son Evangile, et voici qu’il nous faut écouter ce que ce frère pense de l’Eglise. Pour nous, souvent, surprise et déception !
Ce n’est plus de notre foi qu’il nous faut rendre compte, mais de notre Eglise et, cette fois, la parole nous manque. Nous pensions avoir la réponse de la foi et nous voici confrontés – défi non prévu – à la question sans préalable et sans ménagement : « Ton Eglise, c’est quoi ? ».
Si encore nous abordions aux rives de la bienveillante curiosité ou, au moins, de la simple courtoisie ! Non, c’est plutôt au banc des accusés que nous sommes conduits pour répondre de la face cachée de la question : « C’est ça, ton Eglise. Tu as entendu ses déclarations ? Tu as vu ces comportements ? Tu connais son histoire ? Ton Jésus, pourquoi pas ; ton Eglise, certainement pas ! »
Partis avec confiance, voire avec une certaine naïveté, c’est à la méfiance et au soupçon que nous nous heurtons, et même aux plus injustes accusations. Nous n’avions pas prévu que nous nous retrouverions, déconcertés et sans beaucoup d’arguments, commis d’avance avocat, non de notre propre cause, mais de celle de l’Eglise, difficile mission !
Mon Eglise, c’est quoi ?
Comme la réponse est loin d’être simple, peut-être vaut-il mieux ne pas la donner trop vite ! Ne pas dire, par exemple, « L’Eglise, c’est nous ». Oui et non. Chrétiens, certes, nous le sommes effectivement par notre baptême, cette nouvelle naissance d’eau et d’Esprit Saint ; mais ce que nous sommes, nous avons, surtout à le devenir. De plus, entre l’Eglise qui est sainte – telle est notre foi – et l’Eglise des pécheurs que nous sommes, s’imposent quelques nuances et une identité à mieux préciser.
Pour mieux répondre à cette nouvelle question, ne conviendrait-il pas de nous tourner vers l’Eglise et de l’interroger : « Eglise que dis-tu de toi-même ? » Telle est, d’ailleurs, la question qui se trouve dès le départ et tout au fondement de toute la réflexion du Concile Vatican II. Or, la réponse donnée par le Concile, avec l’assistance de l’Esprit Saint : la connaissons-nous ?
D’emblée le Concile situe l’Eglise en son propre mystère. Puisque Dieu est Trinité, l’Eglise est reconnue : Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit ; elle est donc constituée par une triple relation.
Comme Dieu est un, l’Eglise de Vatican II est aussi communion ; elle est donc cette part de l’humanité qui est une de l’unité même qui est en Dieu, participante déjà de la communion trinitaire.
Cette unité voulue par le Christ donne sens à sa mort même : « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17,21). Quand ce désir du Christ sera-t-il, pour nous et entre nous, réalisé en plénitude ? Que sera l’Eglise de Jésus Christ quand les divisions n’existeront plus et que les blessures contre l’unité seront enfin guéries ? Et le monde, alors, croira-t-il ?
Enfin, de même que le Christ est Sacrement de Dieu, Sacrement fondamental du salut, le Concile va définir l’Eglise comme Sacrement universel du salut. Elle est donc, elle aussi, cette part d’humanité rejointe par le salut et vraiment façonnée par la mort et la résurrection du Christ. C’est dans le mystère pascal de son Seigneur que l’Eglise est ainsi confessée : signe et cause du salut pour tous les hommes.
1 – Devoir d’intelligence
Reconnaissons que les chrétiens catholiques sont encore loin d’avoir accueilli et exploité tout ce que le Concile – Ecriture et Tradition – nous offre comme doctrine de l’Eglise. Ce qu’est l’Eglise nous ne le savons pas assez, d’où ce devoir et cette exigence de l’intelligence. Il faut donc que l’Eglise se donne des lieux d’intelligence de ce qu’elle est.
Quand le Christ se révèle pour nous révéler qui est Dieu, il révèle aussi son Eglise qu’il annonce et qu’il crée. Le chrétien est donc celui qui écoute et regarde pour mieux comprendre ce qu’est l’Eglise de son Seigneur.
L’histoire du salut est aussi l’histoire de l’Eglise comme nouvelle Eve du nouvel Adam, comme nouveau Peuple de la nouvelle et éternelle Alliance ; l’homme nouveau de la nouvelle création ; la nouvelle Sion : celle qui vient d’en haut et descend du ciel. Et tant d’autres images, comme celle de la Vigne dont Jésus est le cep et nous les sarments.
2 – Devoir de célébration
S’il faut apprendre, il faut aussi célébrer. Dans la liturgie, on apprend ce que l’on célèbre et l’on devient ce que l’on célèbre : Peuple, Corps, Temple. C’est l’Eglise qui célèbre ce qu’elle est : communion. C’est ainsi que, selon la formule célèbre du Père de Lubac : l’Eglise fait l’Eucharistie et l’Eucharistie fait l’Eglise.
Le Concile Vatican II nous a rappelé que l’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, et qu’elle est aussi l’origine et le terme de la mission. La célébration nous rassemble et nous envoie ; elle nous évangélise et elle est, face au monde, évangélisatrice. C’est pourquoi la liturgie, en sa vérité et en sa beauté, est : convocation, création, rédemption et communion.
3 – Devoir de service
Ce que nous devenons par l’écoute, la compréhension et la célébration, comporte un double service : celui de la Gloire de Dieu – car Dieu doit toujours rester premier – et celui du salut du monde. Comme le Christ : il n’est venu que pour la Gloire de Dieu et le salut du monde, selon la belle formule que nous avons après l’oraison sur les offrandes.
Telle est la « pro-existence » du Christ Jésus. Son être, sa vie, sa mort sont « pour nous les hommes et pour notre salut ». Certes, il est Messie et Fils de Dieu, mais il l’est comme Serviteur de Dieu et de tous les hommes ses frères. Tel est bien le message de tout l’Evangile.
L’Eglise, à son tour, ne peut donc être que servante, autre redécouverte du Concile Vatican II. Elle n’est rassemblée que pour être envoyée ; son identité est donc sa mission : toute centrée sur le Christ et offrande pour le monde.
Pour ce monde, elle doit être : sel, lumière, levain… diversité et complémentarité de ses missions. Elle a, en effet, une parole à donner, une lumière à révéler, une vie à offrir. Ce qu’elle reçoit et ce qui la constitue, elle a toujours mission de le donner ; elle n’a de sens qu’en se livrant, elle aussi, comme son Seigneur, tout livré pour le salut du monde.
Ce qu’elle accomplit, elle le fait avec nous et par nous ; c’est ainsi qu’elle se livre aux chrétiens d’abord, et prend ainsi le risque d’être défigurée, trahie, blessée, et par les autres et par les « vases d’argile », ces pécheurs que nous sommes (Cf. 2 Cor 4,7).
Il faut pourtant que le message et la vie ‘passent’ ; il faut que la mission reçue ‘passe’, c’est-à -dire soit crédible, attirante, séduisante, qu’elle soit aussi comprise, reçue, vécue. L’Eglise est donc en mission ; en campagne, jamais !
Les failles, cependant, entre elle et le monde, ne peuvent pas ne pas exister. Comme le Christ, elle n’est pas du monde. Pour celui-ci, l’Evangile est folie ; l’Eglise et les chrétiens doivent veiller à ce qu’il le reste. Du monde à elle, et inversement, il n’y a pas continuité, mais rupture. Il faut donc que le face à face soit maintenu, mais, bien sûr, en évitant le dos à dos !
Pour que ces failles ne soient pas définitives et infranchissables, des passerelles s’imposent. Des passerelles et non des ponts, ceux-ci, en effet, sont trop rigides : il ne faut jamais ajouter de la raideur à l’Eglise comme institution ; il faut plutôt lui offrir souplesse et légèreté. Les passerelles, d’ailleurs, comportent aussi une note de risque et d’audace, et cela convient mieux à la mission !
4 – Conclusion
De même que le Christ est l’Envoyé du Père dans le monde, le disciple n’est et ne doit être que l’envoyé du Christ, investi, avec ses frères et dans l’Eglise, de la mission même du Seigneur. Tel est l’enseignement de l’Evangile et celui de Paul.
Le disciple ne peut donc porter au monde que la Parole qui vient de Dieu ; cependant, de même que le Verbe a pris chair en Jésus de Nazareth, il faut que la Parole prenne chair en nos propres vies. La Parole se risque et descend jusque-là  : elle s’incarne dans une vie d’homme et d’une communauté ; elle s’enfonce dans un langage et dans une culture : elle n’a pas d’autre issue !
Une parole sans les limites, la pauvreté, la fragilité, mais aussi la beauté d’une humanité, ne sera jamais une parole selon l’Evangile. L’hérésie qui s’appelle le monophysisme – Jésus n’est que de nature divine et nullement de nature humaine – ne doit jamais se retrouver dans la mission de l’Eglise.
Attention, donc, à cette mode de la transparence qui, en christianisme, sonne faux. Un chrétien transparent risque fort de n’être qu’un inexistant ; par contre, pour témoigner, en vérité, de la Parole même de Dieu et de l’Eglise à qui cette même Parole est confiée, comme Trésor et Dépôt sacré, il est indispensable que le chrétien devienne libre de tout, pur en tout, pauvre de tout, ce qui est tellement plus exigeant qu’une pâlotte transparence !
 « Va chez toi, auprès des tiens, et dis-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde ». Pour convaincre, il faut être convaincu et, pour cela, être porteur d’une expérience de vie qui témoigne de ce que le Seigneur, par son Parole et son Esprit, a fait en nous, a fait de nous.
C’est quoi ton Eglise ? Ce défi est peut-être moins déconcertant que nous pourrions le penser ; ne pourrait-il pas se décliner ainsi : « Dans l’être humain et les communautés que vous formez, montrez-moi le Père que vous aimez, le Seigneur que vous suivez, l’Esprit qui vous envoie ».
Osons aussi nous dire, avec humilité et donc avec vérité, que nous ne serons jamais dignes de la mission. S’il y faut quelques préparations, quelques compétences en théologie et autres domaines, sans oublier quelques vertus : générosité, douceur, humilité, patience – et toutes les autres – il y faut, avant tout et plus que tout, le pardon de Dieu.
C’est le pardon qui fonde la mission que Jésus confie à Pierre, après la pêche miraculeuse. Ce n’est pas pour rien, que le Ressuscité, debout sur le rivage, attend Pierre et les autres, auprès du feu de braise en mémoire de celui qui brûlait dans la cour du grand-prêtre, la nuit du reniement. Ce n’est pas pour rien que Jésus, et par trois fois, demande à Pierre : « M’aimes-tu » afin de pouvoir lui dire : « Pais mes brebis ».
Pourquoi, d’ailleurs, ce « M’aimes-tu plus que ceux-ci ? ». Une référence s’impose à la parabole des deux débiteurs que Jésus propose au pharisien Simon. Avec la conclusion suivante : « Lequel des deux l’en aimera le plus ? » Simon répondit : « Celui-là , je pense, auquel il a fait grâce de plus ». Il lui dit « Tu as bien jugé » (Lc 7,42-43).
Si donc, à Pierre, le Seigneur confie plus et même toute l’Eglise, c’est tout simplement parce que le Seigneur a dû pardonner plus à celui qui l’a trahi plus que les autres. La seule dignité de Pierre, c’est d’avoir pleuré sous le regard de Jésus.
Faut-il, alors, relever le défi du monde jusque-là  : lui révéler nos propres larmes et tous les pardons reçus ?
[1] Interview de Patrick de Carolis par Bertrand Révillon, Panorama, Septembre 2003, p. 15.
[2] Interview de Jean-Claude Guillebaud, la Croix du Vendredi 19.09.2003.